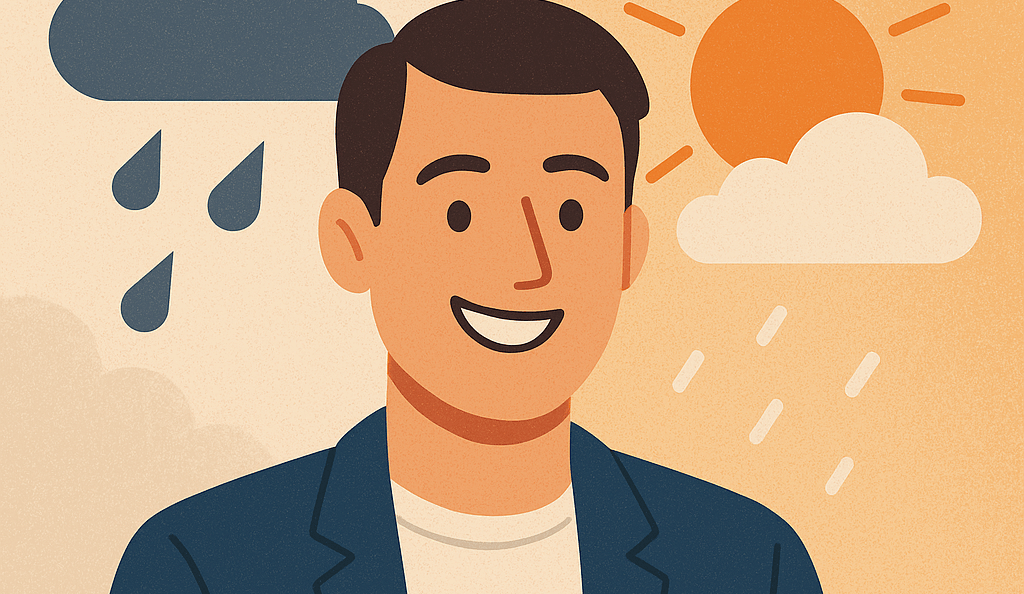Par Benoît Labalette le 25/07/2025
En bref : Ce qu’il faut retenir
-
Le danger invisible : Le biais d’optimisme n’est pas de l’espoir, mais une erreur de jugement qui pousse à croire que « ça n’arrive qu’aux autres ».
-
L’impact : Il conduit à sous-estimer les risques, ignorer les signaux faibles et surestimer sa propre capacité de réponse.
-
La solution : Ne pas chercher à être pessimiste, mais instaurer des rituels de « confiance lucide » (avocat du diable, pré-mortem) pour protéger la prise de décision.
Le biais d’optimisme est notre tendance naturelle et profondément humaine à penser que nous sommes moins susceptibles que les autres de subir un événement négatif. C’est ce qui nous fait dire « ça n’arrive qu’aux autres ». Si cette disposition est un formidable moteur dans la vie de tous les jours, elle devient, en gestion de crise, l’un des pièges mentaux les plus dangereux. Ce « bug » de notre cerveau, même chez les dirigeants les plus expérimentés, conduit à sous-estimer les menaces, à retarder la préparation et à réagir trop tard. L’excès de confiance devient alors le prélude de l’échec.
Chez CriseHelp, nous savons que les plus grandes failles dans un dispositif de crise ne sont pas toujours techniques ou matérielles, mais humaines. Comprendre et savoir contrer le biais d’optimisme n’est pas une option, c’est une discipline stratégique. Cet article vous plonge au cœur de ce mécanisme et vous donne les clés pour construire une culture de la lucidité.
Qu’est-ce que le biais d’optimisme ? Le « tout ira bien » qui nous met en danger
Théorisé par des psychologues comme Daniel Kahneman, le biais d’optimisme n’est pas un défaut de caractère, mais un mode de fonctionnement par défaut de notre cerveau. Il nous protège de l’anxiété au quotidien, mais il déforme notre perception du risque.
Il ne faut pas le confondre avec l’optimisme sain, qui est une attitude positive face à l’avenir. Le biais d’optimisme est une erreur de jugement systématique qui nous fait croire, contre toute évidence statistique, que nous sommes personnellement moins vulnérables. En entreprise, il se traduit par des phrases comme : « Nos systèmes informatiques sont plus sûrs que ceux du voisin qui vient de se faire pirater » ou « Une inondation de cette ampleur, on n’a jamais vu ça ici, ça ne se reproduira pas. »
L’anecdote de la cheffe de mission : une leçon d’humilité sur le terrain
Par Benoît Labalette, consultant partenaire de CriseHelp
L’une des leçons les plus marquantes de ma carrière humanitaire s’est déroulée lors d’une distribution NFI (Non-Food Items – produits de première nécessité) dans un camp de réfugiés en Afrique de l’Est. J’étais alors logisticien. Notre cheffe de mission, que j’appellerai Hélène, était une professionnelle aguerrie, respectée de tous pour son expérience et sa rigueur. Elle avait préparé l’opération à la perfection. Le plan était basé sur les listes officielles fournies par les agences onusiennes : 5000 familles à servir, des kits calculés à l’item près, un circuit de distribution sécurisé. Son optimisme était celui d’une experte qui maîtrise son sujet : « Le plan est robuste, les chiffres sont clairs, la distribution sera fluide. Tout est sous contrôle. »
Mon rôle était de préparer le site de distribution. En inspectant la zone avec mes équipes, j’ai commencé à ressentir un décalage. Je voyais en périphérie de nombreuses tentes de fortune qui ne figuraient sur aucun plan, formant une zone largement surpeuplée. En discutant avec un de mes gardiens, celui-ci m’a glissé : « Beaucoup de nouveaux sont arrivés ces derniers jours, ils n’ont pas encore de papiers… ». Ces signaux faibles contredisaient nos données officielles. La tentation était grande de me fier aux chiffres, à la planification rigoureuse d’Hélène. Remettre en question son plan sur la base d’une « impression de terrain » semblait présomptueux.
Le matin de la distribution, une foule immense, bien plus grande que prévu, se massait déjà. J’ai compris que si nous commencions, nous allions manquer de vivres et créer une bousculade, voire une émeute. J’ai pris mon courage à deux mains et j’ai contacté Hélène par radio : « Hélène, je sais que les listes officielles disent 5000 familles, mais la réalité sur le terrain est différente. La foule est bien plus importante. Si nous ouvrons maintenant, je crains que la situation ne devienne dangereuse. »
Une cheffe de mission moins compétente, aveuglée par son plan parfait, aurait pu balayer mon alerte. Hélène, elle, a fait ce que font les grands leaders. Elle a marqué un silence, puis a répondu calmement : « Reçu. On suspend tout. La sécurité et l’équité priment sur le planning. » Elle a immédiatement organisé une réunion d’urgence avec les leaders communautaires pour trouver une solution : un comptage rapide et une redistribution des rations pour servir tout le monde, quitte à donner moins à chacun ce jour-là.
Ce jour-là, la compétence d’Hélène ne s’est pas manifestée dans la perfection de son plan initial, mais dans sa capacité à écouter un signal faible qui le remettait en cause.
Les 4 manifestations du biais d’optimisme en cellule de crise
L’histoire d’Hélène se rejoue tous les jours dans les cellules de crise, que ce soit dans l’humanitaire ou dans les conseils d’administration de grands groupes. Voici comment le biais d’optimisme se manifeste concrètement :
-
La sous-estimation de la probabilité et de l’impact : C’est le fameux « ça n’arrivera pas chez nous ». Et s’il arrive, « ce ne sera pas si grave ». On minimise les scénarios du pire, jugés trop « alarmistes ».
-
La « planification optimiste » : On élabore des plans de réponse en supposant que tout se passera comme prévu.
-
En entreprise : C’est comme lancer un nouveau produit critique sans tester le plan de reprise informatique, en supposant que les serveurs tiendront la charge car « ils sont neufs ». On ignore la « loi de Murphy ».
-
-
Le refus de voir les signaux faibles : L’équipe se focalise sur les informations qui confirment son scénario optimiste (les chiffres officiels, les tableaux Excel) et ignore les signaux qui le contredisent (le feedback client, le « sentiment » des équipes terrain).
-
La sur-confiance dans sa propre capacité de réponse : « Ne vous inquiétez pas, on a l’habitude, on saura gérer ». Cette confiance, si elle n’est pas basée sur une remise en question permanente et des exercices réguliers, est une illusion dangereuse.
Comment construire une « immunité collective » contre le biais d’optimisme ?
Lutter contre un biais cognitif est difficile car il est inconscient. La solution n’est pas de demander aux gens d’être « moins optimistes », mais de mettre en place des processus et des rituels qui agissent comme des garde-fous.
1. Instaurer le rituel de l’avocat du diable
Dans votre cellule de crise, désignez formellement une personne dont le rôle est de challenger systématiquement le consensus. Sa mission est de poser les questions qui dérangent : « Et si ça ne marchait pas ? », « Avons-nous envisagé le pire scénario ? ».
2. Mener des exercices « pré-mortem »
C’est une technique puissante. Avant de valider un plan stratégique ou de gestion de crise, réunissez l’équipe et annoncez : « Imaginez que nous sommes dans six mois. Notre plan a été un échec total. Maintenant, racontez-moi l’histoire de cet échec. » Cet exercice libère la parole et permet d’identifier toutes les failles que l’optimisme avait masquées.
3. S’appuyer sur des données, mais écouter le terrain
Les données sont essentielles, mais elles peuvent être incomplètes ou datées. Il faut savoir les confronter en permanence avec l’intelligence humaine et les « signaux faibles » qui remontent du terrain.
4. Créer une culture de la sécurité psychologique
C’est la leçon la plus importante de mon anecdote. L’organisation doit créer un climat où chaque membre de l’équipe, quel que soit son grade ou son expérience, se sent légitime à exprimer un doute ou à signaler une anomalie sans craindre d’être jugé.
De l’optimisme béat à la confiance lucide
Lutter contre le biais d’optimisme ne signifie pas devenir pessimiste. Cela signifie passer d’une confiance béate à une confiance lucide. Une confiance qui n’est pas basée sur l’espoir que tout ira bien, mais sur la certitude que l’on s’est préparé au pire de manière rigoureuse. Cela demande de l’humilité, de la discipline et la mise en place de processus qui protègent les décideurs d’eux-mêmes. La véritable force d’un leader n’est pas de ne jamais douter, mais de construire une organisation où le doute est permis et encouragé.
Besoin de challenger vos certitudes ?
Vous craignez que l’habitude ou l’optimisme ne masquent des failles dans votre plan de continuité ? Ne attendez pas la crise pour le découvrir.
Chez CriseHelp, nous sommes spécialisés dans la conception d’exercices de crise sur-mesure pour tester la lucidité de vos équipes.
Contactez-nous pour un audit « Avocat du Diable » de vos procédures
Nous sommes à votre écoute pour préciser votre besoin en gestion de crise.
Nos experts et consultants indépendants sont en mesure de vous accompagner de A à Z dans l’évaluation de vos risques pour anticiper les crises.
FAQs
Questions fréquentes sur le biais d'optimisme
Le biais d'optimisme est-il la même chose que le biais de normalité ?
Ils sont très proches et se renforcent mutuellement. Le biais de normalité est la tendance à croire que les choses vont continuer à fonctionner comme elles l'ont toujours fait. Le biais d'optimisme est la croyance que, même si un problème survient, nous en serons personnellement moins affectés que les autres. Les deux conduisent à une sous-estimation du risque.
Comment convaincre un dirigeant très optimiste de l'importance de se préparer au pire ?
Il ne faut pas attaquer son optimisme, qui est souvent une qualité de leader. Il faut plutôt utiliser des arguments rationnels : la préparation n'est pas un aveu de pessimisme, c'est une bonne pratique de gouvernance, une "assurance" qui protège l'entreprise. L'utilisation d'exemples concrets (benchmarks de concurrents qui ont subi une crise) ou de simulations (comme un exercice pré-mortem) est souvent très efficace.
Ce biais peut-il aussi avoir des effets positifs ?
Dans la vie de tous les jours, oui. Il réduit le stress et encourage à prendre des initiatives. Mais en gestion de crise, où les conséquences d'une erreur sont élevées, ses effets négatifs l'emportent très largement. L'objectif n'est pas d'éliminer l'optimisme (qui est nécessaire pour mobiliser les équipes après une crise), mais d'empêcher le biais d'optimisme de fausser l'analyse du risque en amont.