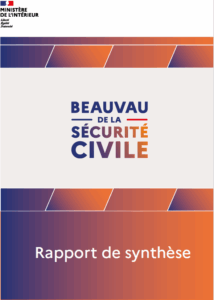Le modèle français de sécurité civile, bien que robuste, est à bout de souffle et doit être profondément refondé pour faire face à la nouvelle ère des « polycrises ». Tel est le verdict sans appel du rapport de synthèse du « Beauvau de la sécurité civile », publié en juillet 2025. Après un an d’une concertation nationale sans précédent, ce document dessine les contours d’un nouveau pacte de résilience, fondé sur une responsabilité plus largement partagée entre l’État, les collectivités, les entreprises et les citoyens.
Loin d’être un simple rapport administratif, ce texte est la feuille de route stratégique qui va guider l’évolution de la gestion de crise en France pour les décennies à venir. Chez CriseHelp, nous avons analysé en profondeur les 156 pages de cette synthèse. Voici notre décryptage des cinq axes de transformation qui vont impacter chaque organisation et chaque territoire.
Ce rapport n’est pas un point final, c’est un point de départ qui ouvre un cycle de réformes attendu sur plusieurs années. Les propositions les plus consensuelles pourraient trouver une traduction réglementaire rapide, tandis que les chantiers les plus lourds, comme la réforme du financement, nécessiteront des débats parlementaires et des arbitrages interministériels dont l’échéance reste à définir.
Le diagnostic : un modèle français performant mais au point de rupture
Le rapport s’ouvre sur un paradoxe. D’un côté, il salue la solidité et l’agilité d’un modèle unanimement reconnu, qui repose sur une chaîne de commandement claire (maire-préfet) et sur l’engagement exceptionnel de ses acteurs, dont 81% sont des volontaires ou des bénévoles.
De l’autre, il dresse le constat d’un système « sous tension », fragilisé par des faiblesses structurelles profondes :
- Un déficit d’anticipation stratégique : La gestion des risques est encore trop souvent « à vue », dans une logique réactive de court terme qui met les budgets et les moyens sous pression constante.
- Une sur-sollicitation opérationnelle : Les interventions des secours augmentent de manière exponentielle, notamment pour des missions de secours à personne qui ne relèvent pas toujours de l’urgence vitale, ce qui épuise les personnels et les détourne de leurs missions fondamentales.
- Une culture du risque citoyenne en recul : Moins de la moitié des Français sont formés aux gestes qui sauvent, et 80% s’estiment mal préparés face aux catastrophes. Cette faible résilience de la population reporte tout le poids de la réponse sur des services institutionnels déjà saturés.
Face à cet « risque tangible de décrochage opérationnel », le Beauvau propose de repenser le modèle sur cinq piliers.
Axe 1 : Repenser les missions – sortir de la dépendance au secours à personnes
Le cœur du problème opérationnel identifié par le rapport est la part écrasante prise par le Secours et Soins d’Urgence aux Personnes (SSUAP), qui représente aujourd’hui plus de 80% de l’activité des pompiers. Cette mission, partagée avec les SAMU, est devenue « dimensionnante en matière d’effectifs, de potentiels opérationnels, de matériels et, par conséquent, de budgets ».
Cette dépendance a des conséquences graves : elle crée une perte de sens chez des pompiers qui se sentent devenir des « ambulanciers de l’urgence sociale », elle émousse leurs compétences sur leur cœur de métier (la lutte contre l’incendie) et elle engendre des tensions de gouvernance et de financement avec le monde de la santé.
Pour y remédier, le rapport préconise une réforme profonde :
- Instaurer une gouvernance interministérielle (Intérieur-Santé) pour piloter l’aide médicale urgente et clarifier le « qui fait quoi, qui paie quoi ».
- Généraliser les plateformes communes d’appels (15-18-112) pour mieux orienter les demandes et n’envoyer les pompiers que lorsque c’est nécessaire.
- Mieux intégrer les associations agréées (AASC) dans cette chaîne de secours pour des missions non urgentes.
Axe 2 : Le citoyen au cœur du jeu – le pari de la résilience partagée
Le constat du rapport est sévère : le principe de la loi de 2004 affirmant que « la sécurité civile est l’affaire de tous » n’a pas suffisamment infusé dans la société. Pour y remédier, le Beauvau propose un changement d’échelle radical pour faire de chaque citoyen un véritable acteur de sa propre sécurité.
Cette ambition se décline en un plan d’acculturation massif :
- L’objectif de 80% de la population formée aux premiers secours doit être atteint via des mesures fortes : intégration systématique dans le parcours scolaire (collège, lycée), dans le Service National Universel (SNU), et incitations via le Compte Personnel de Formation (CPF) ou des crédits d’impôt.
- La création d’un « parcours de vie du citoyen résilient », avec un « passeport de formation » qui validerait les compétences acquises à chaque étape.
- Le renforcement de l’engagement citoyen, en soutenant et en généralisant les Réserves Communales de Sécurité Civile (RCSC) et en valorisant le bénévolat au sein des AASC.
- Une communication grand public, sur le modèle de la Sécurité Routière, pour ancrer les bons réflexes (comme la préparation d’un kit d’urgence).
Axe 3 : Piloter le continuum – le défi de la coordination
La gestion de crise est une « coproduction » qui implique une myriade d’acteurs. Pour éviter le « morcellement » et la « dispersion des initiatives », le rapport insiste sur la nécessité de renforcer le pilotage à tous les niveaux.
Le concept de « continuum de sécurité civile » est ici central. Il s’agit de mieux articuler toutes les phases de la gestion d’un risque : la prévention en amont (dans les plans d’urbanisme), la planification (ORSEC, PCS), la préparation opérationnelle (exercices), la réponse d’urgence, et enfin, la gestion post-crise et le relèvement des territoires (la reconstruction durable).
Les propositions visent à fluidifier cette chaîne :
- Renforcer l’échelon zonal (EMIZ et préfet de zone) pour mieux piloter les crises dépassant les frontières d’un département.
- Simplifier et numériser la planification, jugée trop lourde et complexe, avec la création d’un ORSEC numérique.
- Garantir l’interopérabilité des outils numériques (NexSIS, FR-Alert, SYNERGI…) pour que tous les acteurs partagent la même information en temps réel.
Axe 4 : L’engagement – réinventer la vocation face aux nouvelles générations
Le modèle français de sécurité civile, qui repose à 81% sur des volontaires et des bénévoles, fait face à une crise de l’engagement. Les nouvelles générations ont un rapport différent au travail et à l’engagement, plus axé sur la recherche de sens et la flexibilité.
Pour rendre ces carrières plus attractives et pérennes, le rapport préconise de :
- Déconstruire l’image caricaturale du « héros » pour mieux refléter la diversité des métiers et attirer des profils plus variés, notamment féminins.
- Fluidifier les parcours de carrière en créant des passerelles entre les fonctions publiques, le privé et le monde associatif.
- Sécuriser juridiquement l’engagement volontaire (SPV) face au droit européen, tout en le valorisant davantage auprès des employeurs via des incitations fiscales concrètes.
- Reconnaître les AASC comme des partenaires à part entière, en simplifiant leurs procédures administratives et en consolidant leur modèle économique.
Axe 5 : Gouvernance et financement – qui décide, qui paie et comment ?
C’est le sujet le plus sensible. Le rapport qualifie le système de financement actuel d' »à bout de souffle », complexe et inadapté aux nouveaux risques. Les pistes de réforme sont audacieuses :
- Réformer la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA), en révisant ses critères de répartition pour mieux prendre en compte l’exposition réelle des territoires aux risques.
- Explorer de nouvelles sources de financement, comme une taxe additionnelle sur la taxe de séjour dans les zones touristiques qui génèrent une forte activité de secours.
- Clarifier la facturation des interventions « indues », notamment les carences ambulancières, en faisant davantage contribuer le système de santé.
- Engager une réflexion avec les assureurs sur la prise en compte de la « valeur du sauvé » : l’action des secours permet d’économiser des milliards d’euros aux assurances, une « externalité positive » qui pourrait être réinvestie dans la prévention.
- Simplifier la gouvernance locale, en envisageant un « Acte II de la départementalisation » qui confierait le financement des SIS au seul Département, pour plus de clarté.
Ce que le Beauvau de la sécurité civile change pour vous
Ce rapport n’est pas qu’une affaire d’initiés. Ses orientations vont impacter directement toutes les organisations.
Si vous êtes un élu local (maire, président d’intercommunalité)…
Attendez-vous à des responsabilités accrues en matière de mobilisation et de formation de vos citoyens (via le PCS et la RCSC). En contrepartie, vous devriez bénéficier de plus de soutien et d’accompagnement de la part des services de l’État pour l’élaboration de vos plans et la conduite d’exercices. Votre rôle de premier maillon de la résilience territoriale sera renforcé.
Si vous êtes un dirigeant d’entreprise (PME, ETI, grand groupe)…
L’implication pour que votre entreprise devienne un acteur de la résilience collective va s’intensifier. On attendra de plus en plus de vous que vous disposiez d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) robuste, que vous participiez aux exercices locaux, et que vous facilitiez l’engagement de vos salariés dans les réserves. La résilience devient un critère de votre responsabilité sociétale (RSE).
Si vous êtes un citoyen…
Le message du rapport est clair : le temps du citoyen purement « protégé » est révolu. Le modèle de demain est celui du citoyen « acteur » de sa propre sécurité. Attendez-vous à voir se multiplier les opportunités de formation aux premiers secours (à l’école, au travail, via le CPF). L’État va renforcer la communication sur la nécessité de préparer son Plan Individuel de Mise en Sûreté (PIMS) et son kit d’urgence. Votre autonomie pendant les premières 72h d’une crise devient un objectif de politique publique.
Si vous êtes un acteur de la sécurité civile (pompier, bénévole d’AASC)…
Ce rapport est d’abord le vôtre. Il valide la reconnaissance de la tension extrême que vous subissez au quotidien, notamment sur les missions de secours à personne. Attendez-vous à des débats intenses et à des réformes structurelles sur vos missions, votre statut, vos carrières et votre financement. Le Beauvau ouvre une fenêtre d’opportunité historique pour moderniser et pérenniser votre engagement, que vous soyez professionnel, volontaire ou bénévole.
Si vous êtes un assureur…
Le rapport vous identifie comme un partenaire stratégique majeur mais sous-utilisé. La tendance de fond est de vous faire passer d’un rôle de simple « réparateur » à un rôle d’investisseur dans la prévention. Attendez-vous à être de plus en plus sollicité pour participer au financement de la sécurité civile (via une réforme de la TSCA) et à ce que la notion de « valeur du sauvé » devienne un argument central dans les discussions avec les pouvoirs publics. En parallèle, votre exigence de plans de continuité robustes de la part de vos clients professionnels est validée et encouragée.
Vers un nouveau pacte de résilience national
Le Beauvau de la sécurité civile dessine les contours d’une transformation profonde. Il acte la fin d’un modèle où la sécurité est déléguée aux seuls professionnels et promeut un nouveau pacte où la résilience est l’affaire de tous. C’est une vision exigeante, qui demande un investissement massif dans la formation, la planification et la coordination. Mais c’est sans doute la seule réponse possible à la hauteur des crises qui nous attendent.
Chez CriseHelp, nous sommes convaincus que la résilience est une compétence qui se construit. Les orientations de ce rapport valident notre approche : aider chaque organisation, publique ou privée, à trouver sa juste place dans cet écosystème, à renforcer sa propre préparation et à devenir un acteur à part entière de cette sécurité collective.
Nous sommes à votre écoute pour préciser votre besoin en gestion de crise.
Nos experts et consultants indépendants sont en mesure de vous accompagner de A à Z dans l’évaluation de vos risques pour anticiper les crises.
FAQs
Questions fréquentes sur le Beauvau de la sécurité civile
Qu'est-ce que le "Beauvau de la sécurité civile" en une phrase ?
C'est une vaste concertation nationale menée en 2024-2025 par le ministère de l'Intérieur avec tous les acteurs du secours en France pour dresser un bilan du modèle de sécurité civile et proposer des pistes de réforme pour l'adapter aux nouveaux risques.
Quelle est la proposition la plus importante de ce rapport pour les citoyens ?
La proposition la plus structurante est de faire de chaque citoyen un acteur de sa propre sécurité. Cela passe par un plan massif de formation aux premiers secours (avec un objectif de 80% de la population), une meilleure sensibilisation aux risques dès l'école, et un encouragement à l'engagement bénévole ou volontaire.
Quel est l'impact de ce rapport pour une entreprise privée ?
L'impact est double. D'une part, le rapport insiste sur la nécessité d'une meilleure résilience collective, ce qui implique que les entreprises seront de plus en plus incitées à se doter de plans de continuité d'activité robustes. D'autre part, il appelle à un renforcement des partenariats public-privé, notamment en facilitant la disponibilité des salariés qui sont engagés comme sapeurs-pompiers volontaires ou bénévoles.