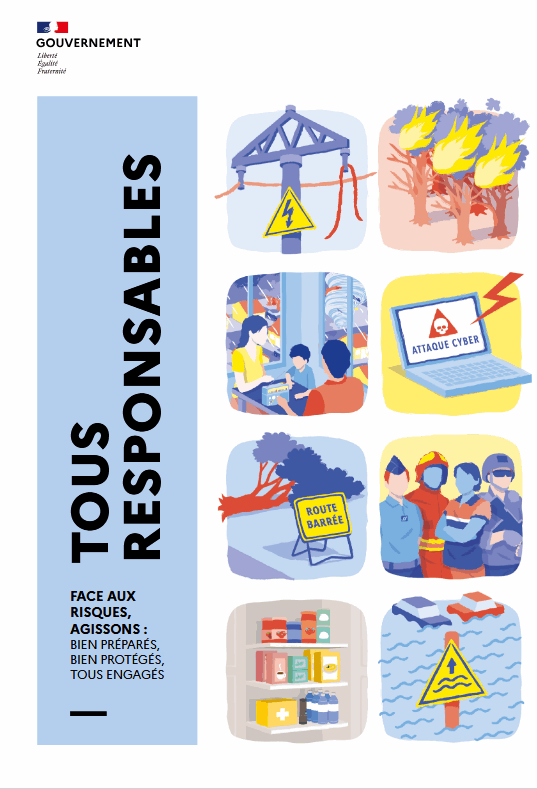Face à l’intensification systémique des menaces — qu’elles soient climatiques, technologiques ou géopolitiques — l’État français opère une mutation profonde de son modèle de sécurité civile. La campagne « Tous responsables face aux risques », matérialisée par la diffusion massive de guides pratiques, n’est que la partie émergée d’un changement de doctrine majeur initié par le Beauvau de la sécurité civile. Pour les décideurs publics (maires, préfets) et privés (dirigeants, risk managers), comprendre cette nouvelle architecture de la résilience est impératif. Il ne s’agit plus seulement de protéger, mais de préparer la nation entière à « faire face » de manière autonome et coordonnée.
Le contexte : la fin du modèle de sécurité « tout-État »
Pendant des décennies, le modèle français de sécurité civile reposait sur une promesse implicite : en cas de catastrophe, l’État et les secours interviennent immédiatement pour tout résoudre. Ce modèle a vécu. La multiplication des crises simultanées (les « polycrises » ou « permacrises ») et l’intensité croissante des aléas climatiques imposent un partage de la responsabilité.
Le gouvernement, à travers cette campagne, délivre un message de lucidité : les secours ne pourront pas être partout, tout de suite, pour tout le monde. La résilience nationale repose désormais sur un pacte social où chaque citoyen, chaque famille et chaque organisation devient le premier maillon de la chaîne de secours.
Cette doctrine s’articule autour d’un triptyque structurant : « Bien préparés, bien protégés, tous engagés ». Pour les professionnels de la gestion de crise, cela implique de passer d’une planification théorique à une culture opérationnelle du risque partagé.
Pilier 1 : l’autonomie stratégique des 72 heures
La pierre angulaire de cette nouvelle stratégie est l’autonomie des populations. Le guide gouvernemental insiste lourdement sur la règle des 72 heures. Pourquoi ce délai ? C’est le temps moyen nécessaire pour que les secours lourds se déploient, sécurisent les axes et priorisent les interventions vitales.
La logistique de survie comme acte citoyen
Se préparer n’est pas un acte survivaliste, c’est un acte de civisme. En étant autonome, le citoyen ne surcharge pas les lignes d’urgence et permet aux pompiers et au SAMU de se concentrer sur les personnes en détresse vitale. Le kit d’urgence détaillé par le gouvernement est précis. Il doit être facile d’accès et contenir :
-
L’hydratation et la nutrition : Il est impératif de stocker 6 litres d’eau par personne (2 litres par jour pour boire et une hygiène sommaire) ainsi que de la nourriture ne nécessitant aucune cuisson (conserves, barres énergétiques).
-
La rupture énergétique : En cas de « black-out », la lampe de poche, les bougies et surtout la radio à piles deviennent les seuls liens avec le monde extérieur pour recevoir les consignes des autorités.
-
La santé et l’administratif : Une trousse de secours complète, les traitements médicaux chroniques, et la copie des papiers d’identité dans une pochette étanche sont vitaux.
L’implication pour les entreprises
Pour un chef d’entreprise, relayer cette campagne n’est pas anodin. Un collaborateur qui sait sa famille en sécurité et autonome sera psychologiquement plus disponible pour participer au plan de continuité d’activité (PCA) de l’entreprise. La préparation domestique est le socle de la résilience professionnelle.
Matrice de déclinaison opérationnelle de la campagne "Tous responsables"
Comment traduire les trois piliers de la campagne gouvernementale en actions concrètes pour les collectivités et les entreprises ? Voici une grille de lecture stratégique.
| Pilier gouvernemental | Objectif stratégique | Actions pour les collectivités (maires/élus) | Actions pour les entreprises (dirigeants/RSE) |
|---|---|---|---|
| 1. BIEN PRÉPARÉS (L'autonomie) | Assurer la survie sans aide extérieure pendant 72h. | Intégrer le concept de résilience individuelle dans le PCS. Organiser des achats groupés de kits d'urgence pour les administrés vulnérables. | Sensibiliser les salariés au risque domestique (Family Welfare). Stocker des kits de survie sur site pour le personnel bloqué. |
| 2. BIEN PROTÉGÉS (La connaissance) | Connaître les signaux d'alerte et les réflexes de sauvegarde. | Tester les sirènes et organiser des exercices FR-Alert réguliers. Mettre à jour le DICRIM. | Former aux cyber-gestes. Intégrer les alertes météo et préfectorales dans la boucle décisionnelle du comité de direction. |
| 3. TOUS ENGAGÉS (La cohésion) | Transformer la population en force d'appui aux secours. | Créer ou renforcer la réserve communale de sécurité civile (RCSC). Former les agents aux gestes qui sauvent (GQS). | Signer des conventions de disponibilité pour les pompiers volontaires/réservistes. Financer des formations au secourisme (SST). |
Pilier 2 : la révolution technologique et culturelle de l’alerte
Être protégé, c’est d’abord être informé. La campagne met en lumière une modernisation drastique des vecteurs d’alerte en France, passant d’une logique de sirène « aveugle » à une logique de notification ciblée et enrichie
.
FR-Alert : le changement de paradigme
Le dispositif FR-Alert est au cœur de cette stratégie. Contrairement aux systèmes précédents basés sur les SMS (qui congestionnaient les réseaux), FR-Alert utilise la diffusion cellulaire (Cell Broadcast).
-
Comment ça marche ? Les antennes relais d’une zone de danger envoient un signal radio à tous les téléphones 4G/5G présents dans la zone, sans saturation possible.
-
Pourquoi est-ce vital ? La notification force le mode silencieux du téléphone avec un signal sonore spécifique et, surtout, elle donne la consigne exacte (ex : « Montez aux étages », « Confinez-vous », « Évacuez vers le point Z »). Pour les décideurs locaux, intégrer FR-Alert dans les scénarios d’exercices est une priorité absolue pour acculturer la population à ne pas paniquer à la réception de ce signal strident.
Les menaces hybrides et la guerre de l’information
Le guide gouvernemental fait une place inédite aux menaces immatérielles, signe des temps. Il aborde frontalement le risque de cyberattaques et de désinformation. En situation de crise (attentat, catastrophe industrielle), la propagation de rumeurs ou de « fake news » (parfois orchestrées par des puissances étrangères pour déstabiliser l’État) est un facteur aggravant majeur. Le guide préconise une « hygiène informationnelle » stricte : vérifier la source, repérer les dates, et ne faire confiance qu’aux canaux officiels (préfecture, mairie, gouvernement). Pour les directeurs de la communication, cela impose d’être prêt à occuper le terrain médiatique immédiatement pour ne pas laisser le vide s’installer face à la désinformation.
Pilier 3 : l’engagement citoyen comme ressource opérationnelle
Le dernier volet, « Tous engagés », vise à densifier le tissu de sécurité civile. L’État reconnaît explicitement qu’il a besoin des citoyens.
Les réserves : un vivier indispensable
La campagne fait la promotion active des différents corps d’engagement :
-
Les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) : Qui constituent l’ossature du secours en France.
-
Les réserves communales de sécurité civile (RCSC) : Placés sous l’autorité du maire, ces bénévoles sont essentiels pour le soutien logistique (déblaiement, hébergement d’urgence, distribution alimentaire).
-
La garde nationale et les réserves militaires : Dans un contexte de retour des conflits de haute intensité, le lien Armée-Nation est réaffirmé comme un pilier de la souveraineté.
La solidarité de proximité
Au-delà des cadres formels, la campagne insiste sur la « communauté d’entraide ». Connaître ses voisins, identifier les personnes âgées isolées dans son immeuble, ou savoir utiliser un défibrillateur sont des actions de résilience concrètes. Pour une collectivité, cartographier ces solidarités informelles peut faire la différence lors d’une canicule ou d’une inondation.
Actualité : Beauvau de la sécurité civile et Journée nationale de la résilience
Cette campagne s’inscrit dans une séquence politique cohérente. Le Beauvau de la sécurité civile a posé le diagnostic d’un système à bout de souffle face au changement climatique, nécessitant une refonte des moyens et des doctrines.
L’instauration de la Journée nationale de la résilience (JNR), chaque 13 octobre, offre désormais un cadre temporel aux organisations pour agir. Ce n’est plus une option : c’est le moment de l’année où les entreprises doivent tester leur PCA, où les écoles activent leur plan particulier de mise en sûreté (PPMS) et où les mairies déploient leur PCS en grandeur nature. Participer à la JNR permet de bénéficier d’une visibilité nationale et de crédibiliser sa démarche de prévention.
De la prise de conscience à la planification
La campagne « Tous responsables » est un appel à l’action. Pour les dirigeants, ignorer ce changement de doctrine serait une faute stratégique. La résilience de votre organisation dépendra de votre capacité à vous insérer dans ce dispositif national, à encourager l’autonomie de vos équipes et à préparer la continuité de vos opérations dans un environnement dégradé.
CriseHelp se positionne comme votre partenaire stratégique dans cette transition. Nos experts, issus des corps de commandement de la sécurité civile et de la gestion de crise militaire, maîtrisent parfaitement cette nouvelle doctrine. Nous vous accompagnons pour auditer vos plans de sauvegarde, former vos élus à la gestion de crise communale et sensibiliser vos collaborateurs lors de la prochaine Journée nationale de la résilience.
Votre plan communal de sauvegarde est-il conforme à la nouvelle doctrine ?
Ne restez pas sur des schémas obsolètes. Préparez votre organisation aux défis de demain avec l'expertise CriseHelp.
Audit et accompagnement sur-mesureNous sommes à votre écoute pour préciser votre besoin en gestion de crise.
Nos experts et consultants indépendants sont en mesure de vous accompagner de A à Z dans l’évaluation de vos risques pour anticiper les crises.
FAQs
Quel est le lien entre le Beauvau de la sécurité civile et cette campagne ?
Le Beauvau de la sécurité civile est la phase de concertation stratégique qui a défini les besoins de modernisation face aux crises futures. La campagne « Tous responsables » est la déclinaison opérationnelle et grand public de cette réflexion, visant à instaurer une véritable culture du risque en France pour soulager les services de secours.
Pourquoi insister autant sur l'autonomie de 72 heures ?
L'expérience des crises récentes (tempête Alex, inondations dans le Pas-de-Calais) montre que les accès peuvent être coupés pendant plusieurs jours. L'autonomie de 72h permet de « tenir » en attendant le rétablissement des réseaux ou l'arrivée des secours, qui priorisent d'abord les urgences vitales absolues.
En quoi FR-Alert est-il différent des anciennes sirènes ?
Les sirènes (RNA) émettent un son qui signale un danger sans préciser sa nature. FR-Alert envoie une notification textuelle et sonore sur les mobiles, précisant la nature du risque (ex: feu de forêt, attentat), la localisation et surtout la conduite à tenir (ex: ne pas aller chercher les enfants à l'école). C'est un outil beaucoup plus directif et efficace.
Comment lutter contre la désinformation en temps de crise selon le guide ?
Le guide recommande une méthode en quatre temps : vérifier l'émetteur (qui parle ?), vérifier le caractère officiel de la source (badge certifié, site en .gouv.fr), vérifier si l'info est reprise par un média national fiable, et s'interroger sur le but du message. En cas de doute, il ne faut jamais relayer pour éviter de créer des mouvements de panique injustifiés.
Quel est le rôle des entreprises dans ce dispositif ?
Les entreprises sont des acteurs clés. Elles doivent protéger leurs salariés, mais peuvent aussi contribuer à la résilience nationale en facilitant l'engagement de leurs employés réservistes ou pompiers volontaires (conventions de disponibilité), et en intégrant la culture du risque dans leur stratégie RSE et RH.